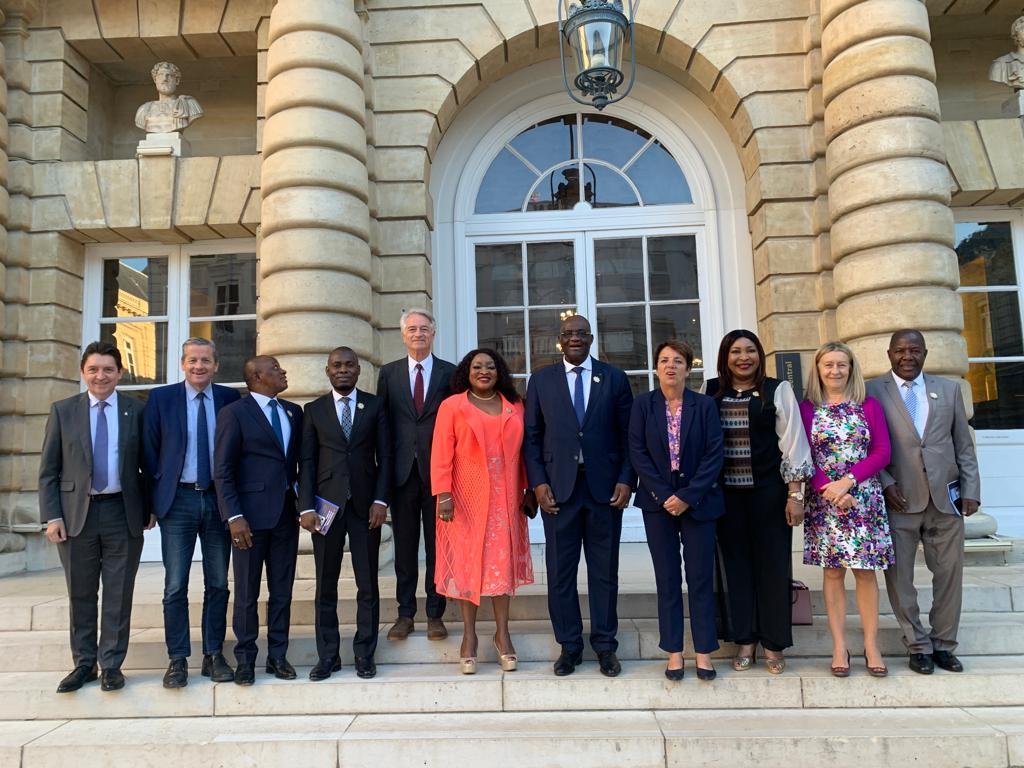Avec une contribution de 4,5% du PIB agricole et 2% du PIB total, le secteur des ressources animales et halieutiques ivoirien est loin d’exploiter tous ses potentiels. Le gouvernement est résolument mobilisé afin d’en améliorer la productivité et la compétitivité.
Vous êtes Ministre des Ressources Animales et Halieutiques. Pouvez-vous précisément nous parler de ces ressources ?
Le secteur des ressources animales et halieutiques comprend les sous-secteurs de l’élevage, de la pêche, de l’aquaculture et de la santé publique vétérinaire. Ainsi, le Ministère assure la régulation de la production et la gestion des espèces d’élevage, des animaux de compagnie, de toutes les espèces de pêche et de la sécurité sanitaire des aliments.
L’on dénombre six filières majeures : Pêche, Aquaculture, Bétail-viande-Lait (Bovin, ovins, caprins), filière porcine, filière avicole et la filière des élevages en développement (l’apiculture, la cuniculture, l’achiniculture, l’aulacodiculture et la sériciculture, etc.).
Quel est leur poids dans l’économie ivoirienne ?
Le secteur des ressources animales et halieutiques est pourvoyeur d’emplois avec plus de 700 000 emplois et une contribution de 4,5% du PIB agricole et 2% du PIB total (INS, 2020). De façon spécifique, la pêche artisanale occupe une grande part dans la pêche nationale avec une production qui est passée de 33 243 tonnes en 2008 pour une valeur de 15 milliards FCFA à 61 307 tonnes en 2022 pour une valeur de 73,568 milliards FCFA. Quant à la production de la pêche industrielle, elle était de 12 042 tonnes pour une valeur de 4 milliards de francs CFA en 2008 contre 17508 tonnes en 2022 pour une valeur de 15,36 milliards de FCFA.
Enfin, la filière avicole contribue fortement à la création d’emploi en faveur des jeunes avec une production globale de 132 401 tonnes en 2022 pour une valeur de 255 milliards de FCFA.
À quelles problématiques ces secteurs sont-ils confrontés ?
La production nationale des ressources animales et halieutiques fait face à une faible contribution aux besoins nationaux en raison de sa faible productivité et sa faible compétitivité.
Plusieurs causes sous-jacentes justifient ces insuffisances, au niveau de la production animale, le problème se décline en une faible valorisation des ressources pastorales, du fait de la prédominance des systèmes de production traditionnelle et la dégénérescence génétique du cheptel, qui est en proie à des difficultés d’accès à l’eau, aux pâturages et aux intrants ; des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs ; de faibles capacités techniques et organisationnelles des acteurs des différentes filières ; de l’insuffisance des équipements et infrastructures d’appui à la production ; et de la faible valorisation des résultats de la recherche-développement du fait du faible niveau de l’appui-conseil, l’inexistence d’un dispositif efficace de la surveillance épidémiologique des maladies animales et la faible couverture vaccinale.
Aussi, il est observé des faiblesses institutionnelles dans la coordination et le pilotage du secteur du fait de l’insuffisance des ressources humaines ; la dispersion des interventions et l’absence d’un système opérationnel de collecte et de gestion des statistiques.
Au niveau de la pêche, la Côte d’Ivoire dispose d’infrastructures importantes d’appui au développement du secteur. Le niveau d’équipement actuel du port de pêche d’Abidjan est suffisamment viable pour accueillir des navires à fort tirant d’eau. Quant à la pêche artisanale, elle, souffre d’une faible capacité de défense de ses intérêts dans les politiques de mise en valeur des espaces côtiers et marins (compétition spatiale avec l’industrie pétrolière, urbanisation, diverses pollutions, etc…). d’une faiblesse du système d’encadrement de la pêche et d’une installation limitée d’infrastructures appropriées, notamment les débarcadères, les marchés de poisson, les points de production et de fourniture de glace, etc… l’insuffisance du système de programmation participatif de la recherche scientifique, l’importance de la pêche INN.
Au niveau de l’aquaculture, il existe cependant des contraintes pour lesquelles des solutions appropriées peuvent être trouvées, y compris dans le cadre de Partenariats Public Privé, ce sont la faible disponibilité d’alevins et d’aliment de qualité ; les difficultés d’accès à la terre ; les insuffisances dans la conception des aménagements piscicoles ; la faible structuration de la chaine de la valeur aquacole et la faible valorisation des produits aquacoles.
Le 1er août 2022 était lancé en présence du Premier Ministre Patrick Achi, le Programme Stratégique de Transformation de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire (PSTACI). Pouvez-vous nous en exposer les tenants et aboutissants ?
La Côte d’Ivoire, malgré son énorme potentiel hydrologique est dépendante des importations pour couvrir les besoins de la population notamment en produits halieutiques. En effet, la consommation nationale en 2022 était estimée à 634 201 tonnes et la production nationale de 85 726 tonnes soit un taux de couverture de 13, 60% donc acculée à recourir aux importations massives pour couvrir les besoins de sa population en constante augmentation avec un taux de croissance de 2,6 % par an.
Pour faire face à ce déficit, la Côte d’Ivoire a fait le choix stratégique d’accroître son potentiel de production aquacole. C’est pourquoi le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques a initié le Programme Stratégique de Transformation de l’Aquaculture en Côte d’Ivoire (PSTACI), qui ambitionne de lever les contraintes au développement de l’aquaculture afin de permettre la couverture totale des besoins en poissons par la production nationale, éviter les sorties importantes de devises et garantir des emplois durables à la jeunesse ivoirienne.
À terme, ce programme permettra au bout des dix années de mise en œuvre :
• La réduction de la pauvreté. Le taux de pauvreté (% de la population) en Côte d’Ivoire était de 46,3% en 2015.
• La réduction du chômage des jeunes. Le taux de chômage officiel (2017) était de 3,3%. Cependant, seulement 23% des travailleurs sont employés dans des emplois salariés. Chaque année, 250 000 jeunes entrent sur le marché du travail à la recherche d’un premier emploi (la majorité est composée de jeunes).
• La réduction de la facture d’importation de produits halieutiques. La Côte d’Ivoire importe actuellement plus de 80% de sa demande locale de poissons.
Quels autres projets majeurs portez-vous ?
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture (PONADEPA 2022-2026), le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques a initié la formulation de projets structurants et viables pour tenir compte des ambitions, et capables d’apporter des solutions à moyen terme aux problèmes de déficits de production animale et halieutique de la Côte d’Ivoire.
Ce sont au total, vingt-trois nouveaux projets qui ont été mis en place. Il s’agit de deux types de projets en occurrence des projets filières et thématiques. Les projets filières sont portés par une approche de développement et de promotion d’un centre d’application et spécialisation qui se présente comme un incubateur qui allie cadre d’apprentissage et appui à l’installation dans tous les maillons de la chaine de valeur.